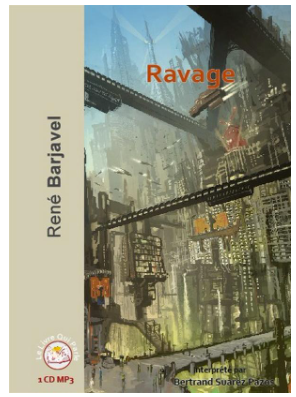
Pourquoi lire en 2025 un roman d’anticipation écrit en 1943 et se déroulant en 2052 ? Est-ce que cela a du sens ?
Je garde un souvenir assez précis de ma lecture de « La Nuit des temps » du même auteur. J’avais 12 ou 13 ans. C’était, peut-être, mon premier vrai roman de science-fiction, et il m’avait profondément marquée.
C’est le hasard qui m’a mis aujourd’hui « Ravage » entre les mains – ou plutôt, dans les oreilles, car je cherchais un roman en version audio.
Le début m’a beaucoup plu : d’abord parce que c’est toujours amusant de voir comment, en 1943, un auteur pouvait imaginer le futur – pas de voiture volante ou autonome, pas de téléphone portable non plus, les ordinateurs sont absents. En revanche toute la société tourne à l’électricité. Et le jour où celle-ci est complètement coupée, c’est le chaos. La société s’effondre. Les morts, soigneusement conservés depuis plusieurs générations dans des lieux réfrigérés dans les habitations, se putréfient. Le choléra rôde. Toute cette partie résonne dans notre actualité : quand la crise énergétique fait l’actualité ; quand on a vécu une pandémie, capable de révéler tantôt la plus grande humanité, tantôt le plus grand individualisme, il n’est pas difficile de faire des rapprochements !
Ensuite les choses se compliquent : François, le principal personnage, décide de quitter la capitale avec la jeune femme qu’il aime et quelques individus qu’il réunit pour former un groupe. Sur leur chemin qui traverse la France, ils vont croiser la maladie, la mort, la faim, et toutes sortes d’horreurs.
Plus le roman progressait, plus je me sentais mal à l’aise. Tant de noirceur dans quelques heures d’écoute… Bien sûr c’est un classique, et je ne regrette pas de l’avoir découvert. Mais j’ai hâte de passer à une lecture moins pesante.

Le Livre qui parle (épuisé), 7h30 d’écoute. Lu par Bertrand Suarez-Pazos
