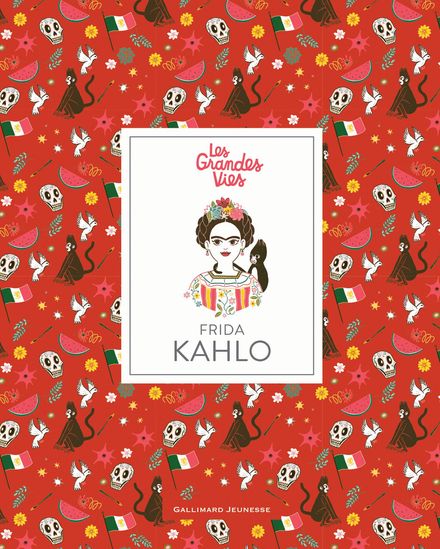
Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à l’art et aux artistes. Vous connaissez mon admiration et ma passion pour Frida Kahlo, mais force est de constater que son œuvre n’est pas facile d’accès, pour les adultes et a fortiori pour les enfants.
Ce petit livre jeunesse très bien fait permet aux 8-13 ans d’entrer dans la vie de l’artiste à travers un récit simple (mais jamais simpliste), de comprendre son enfance, le poids du Mexique dans sa vie, le rôle de la peinture comme moyen d’expression.
Rien n’est caché de ses souffrances (la polio qu’elle a contractée enfant ; son accident de bus qui l’a laissée handicapée ; ses fausses couches ; la tromperie de Diego avec sa propre sœur). J’ai apprécié que les faits ne soient pas édulcorés (même si évidemment les mots sont choisis et le niveau de détail adapté à l’âge des lecteurs). J’aurais trouvé dommage de ne pas montrer toute la souffrance endurée par cette femme, icône de résilience.
L’autre excellente idée est d’avoir parsemé le texte de citations de Frida elle-même. Quant aux illustrations, elles reprennent les idées principales de ses tableaux – mon seul regret est qu’il ne figure qu’une seule petite photo de l’artiste, dans un médaillon sur la frise chronologique en fin de livre. Nul doute cependant que les jeunes lecteurs auront été suffisamment appâtés par ce livre très bien fait pour avoir envie de découvrir les tableaux originaux de Frida Kahlo.

Gallimard jeunesse, 64 pages, 11,90€



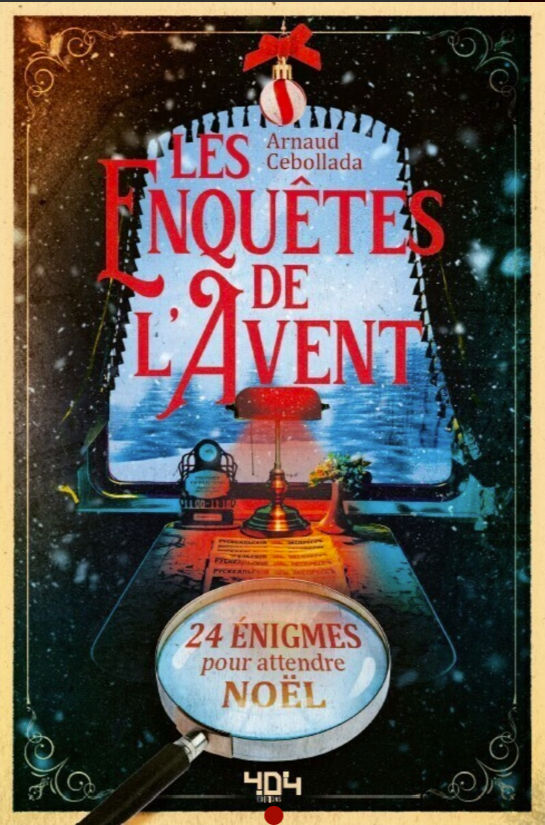

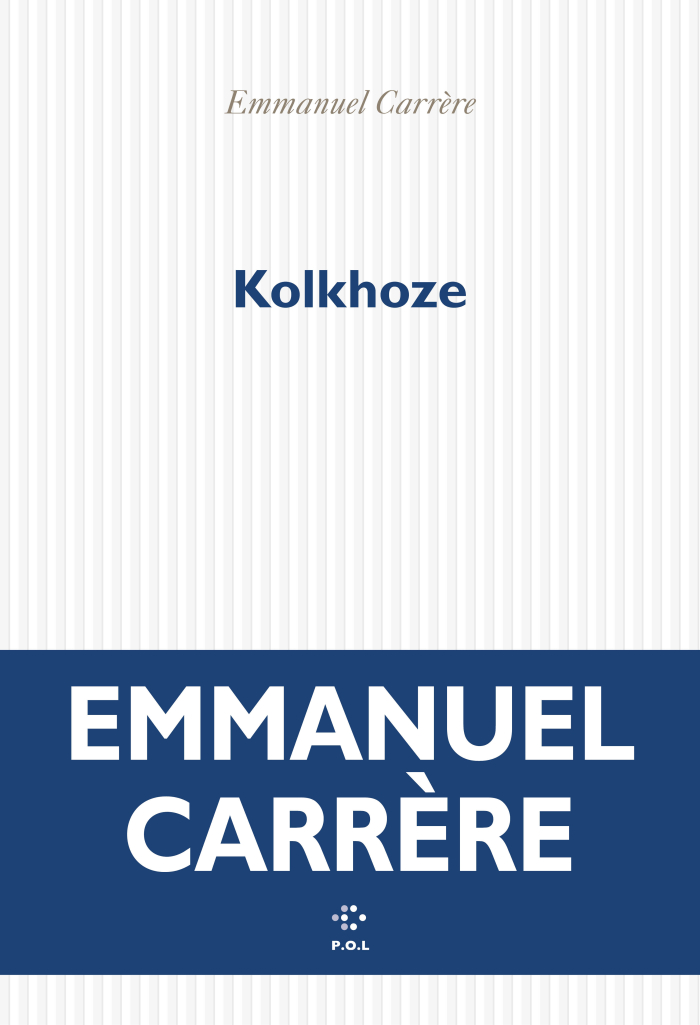
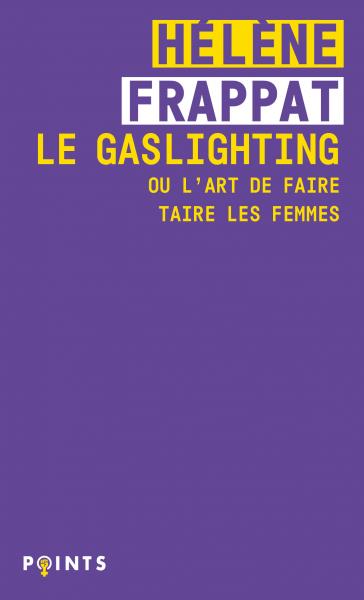
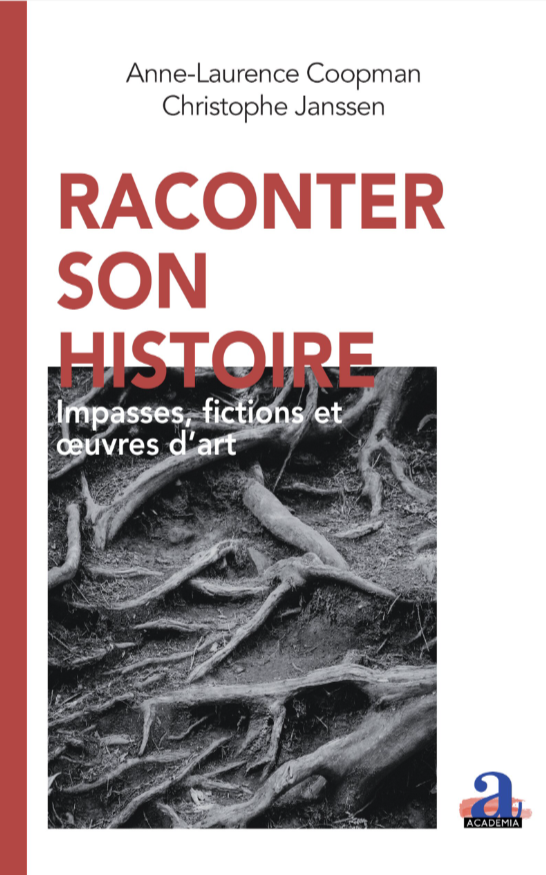 Les récits de vie m’ont toujours intéressée. Qu’il s’agisse de biographies ou autobiographies de grands personnages historiques, ou de textes plus modestes d’anonymes, il se crée toujours à la lecture d’un récit de vie une empathie et le lecteur y gagne, me semble-t-il, un petit bout d’humanité en plus.
Les récits de vie m’ont toujours intéressée. Qu’il s’agisse de biographies ou autobiographies de grands personnages historiques, ou de textes plus modestes d’anonymes, il se crée toujours à la lecture d’un récit de vie une empathie et le lecteur y gagne, me semble-t-il, un petit bout d’humanité en plus.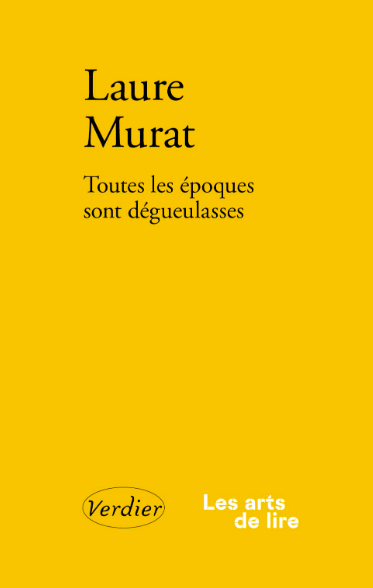 C’est le titre, d’abord, qui m’a interpellée en écoutant un podcast de France Culture où l’auteure était invitée (sans avoir noté au départ que j’avais déjà lu un
C’est le titre, d’abord, qui m’a interpellée en écoutant un podcast de France Culture où l’auteure était invitée (sans avoir noté au départ que j’avais déjà lu un 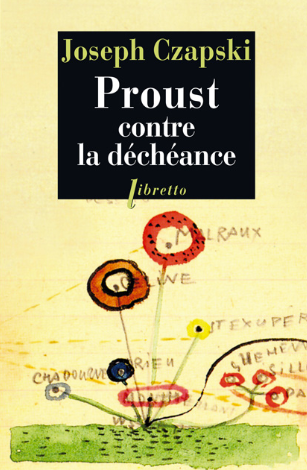 Oui, je le reconnais, le seul nom de « Proust » dans un titre me fait m’arrêter pour feuilleter l’ouvrage en question. Mais dans le cas de ce petit roman, c’est autre chose qui m’a décidée à l’acheter : ce livre est un précieux témoignage. En effet, il regroupe une partie des conférences données par l’auteur lors de son internement dans un camp russe en 1940. Rendez-vous compte : cet homme a été capable de donner une série de conférences d’une impressionnante précision, avec une structure accessible au plus grand nombre, en citant les noms des personnages, les références, etc, de tête. Il n’avait accès ni à l’oeuvre ni à la moindre documentation, évidemment. Une note de début d’ouvrage attire l’attention du lecteur sur certaines approximations – mais ce n’est pas si approximatif que ça !
Oui, je le reconnais, le seul nom de « Proust » dans un titre me fait m’arrêter pour feuilleter l’ouvrage en question. Mais dans le cas de ce petit roman, c’est autre chose qui m’a décidée à l’acheter : ce livre est un précieux témoignage. En effet, il regroupe une partie des conférences données par l’auteur lors de son internement dans un camp russe en 1940. Rendez-vous compte : cet homme a été capable de donner une série de conférences d’une impressionnante précision, avec une structure accessible au plus grand nombre, en citant les noms des personnages, les références, etc, de tête. Il n’avait accès ni à l’oeuvre ni à la moindre documentation, évidemment. Une note de début d’ouvrage attire l’attention du lecteur sur certaines approximations – mais ce n’est pas si approximatif que ça !